 Le statut juridique du jeu vidéo connaît une actualité relativement riche ces derniers mois avec, en septembre, une nouvelle décision concernant la qualification juridique d’une oeuvre vidéo-ludique, et plus récemment en décembre un rapport parlementaire portant sur le régime juridique du jeu vidéo en matière de droit d’auteur.
Le statut juridique du jeu vidéo connaît une actualité relativement riche ces derniers mois avec, en septembre, une nouvelle décision concernant la qualification juridique d’une oeuvre vidéo-ludique, et plus récemment en décembre un rapport parlementaire portant sur le régime juridique du jeu vidéo en matière de droit d’auteur.
Concernant ce dernier, il s’agit d’un document attendu puisqu’il s’agit du premier rapport officiel sur le sujet depuis 2005 et les travaux du Conseil Supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA). Or le milieu du jeu vidéo qui tente de se structurer en une vraie industrie est particulièrement demandeur d’un vrai statut qui éviterait toute incertitude et serait de nature à simplifier la vie des affaires des studios français. Les enjeux d’un tel statut sont multiples mais nous pouvons citer :
- la crainte des revendications patrimoniales de certains salariés ou prestataires,
- la complexité de gestion du droit moral
- la difficulté à rassurer banques, assureurs et investisseurs.
Ce rapport de M. Patrice MARTIN-LALANDE Député de Loir et Cher (ces gens là ne font pas de manière !), apporte des réponses pour le moins mitigées en affirmant tout d’abord que la question du statut juridique des jeux vidéos en matière de propriété intellectuelle, si elle est réelle, n’est pas une priorité absolue en comparaison des autres types de réponses plus économiques qui pourraient être apportées.
Cette conclusion est confortée il faut le dire par une décision de cassation dans l’affaire « CRYO » qui semble être suivie par les autres juridictions, comme en atteste la récente décision annoncée en introduction « Julien F. / Prizee.com, Believe » (Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 30 septembre 2011).
Ce jugement confirme que la musique d’un jeu vidéo (ici un site de mini-jeux sur internet www.PRIZEE.COM ) doit être considérée comme une oeuvre à part entière et non comme un élément de l’oeuvre ludicielle. Ce faisant le TGI éloigne encore une fois le jeu vidéo du bénéfice du statut l’oeuvre collective, si pratique en théorie, et donc préféré par les studios français.
En réalité cette décision me semble bien différente de l’affaire CRYO si l’on veut bien entrer dans les faits. En effet, la mission confiée au salarié concernait le sound design. Il s’agit souvent d’une manoeuvre utilisée par les studios pour écarter le risque juridique de voir reconnaître une protection par le droit d’auteur au travail du musicien. En parlant de sound design, on parle en théorie d’une opération très technique visant à choisir des bruitages et les faire correspondre à certains moments du jeu. Et cela peut s’avérer tout à fait exact. Ce travail peut se trouver tellement intégré au jeu et dépendant de celui-ci, qu’il ne peut être considéré comme une oeuvre à part entière mais uniquement comme une partie d’un tout qui résulte surtout de certaines contraintes imposées par le reste de la production et qui ont deux effets principaux : 1/ mettre en doute l’originalité de la création; 2/ conforter le statut d’oeuvre collective.
Le Tribunal confirme d’ailleurs que le statut d’oeuvre collective n’est pas hors de portée lorsqu’il relève « que certains éléments penchent en faveur de la qualification d’œuvre collective au sens de l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle puisque les œuvres musicales ont été divulguées sous le nom de la société Prizee, réalisées par un salarié et impliquent une contribution personnelle de chaque auteur. »
Cependant le Tribunal relève immédiatement ensuite que « l’ensemble des conditions de l’œuvre collective n’est pas réunie, en l’absence de la preuve d’instructions et alors que, contrairement à ce que soutient la société Prizee.com, la musique ne se fond pas dans l’ensemble que constitue le jeu vidéo, puisqu’on peut l’écouter sans jouer, ainsi que l’établit d’ailleurs la commercialisation par la société Prizee.com d’un CD contenant les créations musicales. ».
Par ailleurs le Tribunal reconnait clairement que le travail réalisé par le salarié est protégeable par le droit d’auteur. C’est l’occasion encore une fois de rappeler aux studios qu’il ne suffit pas de nier le caractère original et créatif pour écarter la protection dont jouit l’auteur de par la loi. Il s’agirait d’un voeu pieux.
Concernant les musiques écoutées sur le CD “Prizee Music”, le Tribunal constate que chacune d’elles constitue une oeuvre protégeable du fait de l’originalité dans leur écriture et du travail de création dont elles sont issues, ajoutant que « Même si comme le revendique Monsieur F., chaque morceau contient des inspirations, ils contiennent tous une mélodie, une harmonie et un rythme et traduisent un univers musical propre, expression de la personnalité de l’auteur.«
Il n’y a certainement pas de doute sur ce point qui sera confirmé en appel si appel il y a. Mais le texte du jugement laisse de fait une place pour le sound design. Celui-ci n’a pas été analysé par les magistrats qui ont fait la part des choses entre les musiques et les effets sonores. Pour ces derniers la qualification d’oeuvre n’est pas évoquée.
La leçon à tirer de cette affaire est que pour l’heure seule la musique est écartée du statut protecteur de l’oeuvre collective. Rien ne peut affirmer que le reste des éléments constitutifs du jeu ne peut pas être considéré comme un tout divulgué sous le nom du studio. Ce tout comprend alors les éléments de sonorisation provenant par exemple de banque de son, ce que l’on pourrait qualifier de « pur sound design ».
Pratiquement il convient donc de bien distinguer le traitement juridique à effectuer contractuellement entre les différentes tâches que peut avoir à effectuer un technicien / compositeur qui a en charge autant la sonorisation que la création de musique originale.
Il me semble que l’erreur de la société PRIZEE.COM pouvait facilement être évitée et qu’il n’y a nulle aporie ici. Simplement la solution a un coût puisque les 50 000 € de condamnations correspondent pour une part à ce que la société aurait dû verser à l’auteur à titre de royalties. Mieux vaut donc le négocier avant afin d’éviter d’avoir à subir l’estimation du tribunal et supporter les frais de la procédure.
Tout cela démontre à mon sens que certaines règles pourraient être précisées légalement par le législateur comme il en va en matière d’oeuvre audiovisuelle pour laquelle les principaux contributeurs devant bénéficier du statut de coauteurs sont définis. Ceci éviterait une grande insécurité pour les studios et aurait le mérite de mettre l’ensemble de la profession sur un pied d’égalité. Aujourd’hui ceux qui souhaitent ne pas prendre de risques verront leur marge diminuer. Certains continueront donc à prendre le risque de s’en remettre à un statut de l’oeuvre collective qu’ils maîtrisent mal et dont le fonctionnement est l’une des plus grandes étrangetés du droit de la propriété intellectuelle français.
Admettons tout bonnement que dans le processus de production certains collaborateurs tiennent une place particulière car leur contribution est soit distinguable du reste (musique), soit particulièrement marquante (Directeur artistique, scénariste d’un jeu d’aventure, etc). Enfin, je me répète, mais tout n’est pas forcément perdu pour le statut d’oeuvre collective.
Gérald SADDE – Avocat têtu !
Référence : MISSION PARLEMENTAIRE SUR LE REGIME JURIDIQUE DU JEU VIDEO EN DROIT D’AUTEUR Rapport de M. Patrice MARTIN-LALANDE Député de Loir et CherMission confiée par le Premier ministre, M. François FILLONauprès du Ministre de la culture et de la communication, M. Frédéric MITTERRAND30 mai – 30 novembre 2011
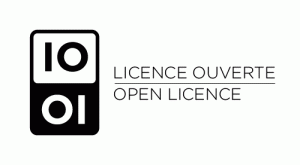 Tout petit article pour mentionner que j’ai ouvert un modeste dossier sur l’OPEN DATA que vous trouverez ici. L’Open Data est un nouveau champ de réflexion pour le droit. L’ouverture des données notamment publiques n’est pas sans poser quelques difficultés mais la détermination des administrations et collectivités locales françaises à avancer dans cette voie est maintenant une réalité.
Tout petit article pour mentionner que j’ai ouvert un modeste dossier sur l’OPEN DATA que vous trouverez ici. L’Open Data est un nouveau champ de réflexion pour le droit. L’ouverture des données notamment publiques n’est pas sans poser quelques difficultés mais la détermination des administrations et collectivités locales françaises à avancer dans cette voie est maintenant une réalité.
